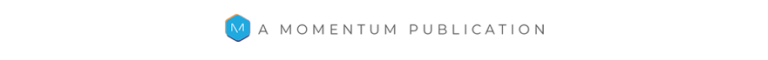4e partie dans notre série sur la révision des Lois sur la radiodiffusion et des télécommunications
L'INDUSTRIE CANADIENNE DE LA télévision fait face à une crise aiguë. Les contributions financières qui supportent la production d’émissions canadiennes diminuent. Et cela est combiné au fait que les fournisseurs de service en ligne, comme Netflix, ne sont pas requis de contribuer au système canadien contrairement à leurs concurrents canadiens.
Depuis l’arrivée en scène de Netflix comme concurrent important des services de radiodiffusion traditionnels, plusieurs ont réclamé que la compagnie américaine contribue au système canadien de radiodiffusion. Certains ont suggéré que taxer les fournisseurs de services Internet serait la meilleure approche. D’autres ont simplement dit que Netflix rencontre la définition d’entreprise de distribution de radiodiffusion et, conséquemment, devrait payer sa part au Fonds canadien des médias, tout comme les câblodistributeurs, les services satellitaires et les distributeurs IP contribuent une partie de leurs revenus au Fonds.
Jay Thompson, PDG de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), est préoccupé parce que tout ce qu’une taxe sur les EDR aurait comme effet est de diminuer les investissements des membres du CCSA pour déployer la large bande dans leur communauté. «Toute politique qui redirigerait de l’argent de ce type d’investissement serait négative pour les Canadiens, en tout cas pour les Canadiens que nous desservons,» a-t-il dit à Cartt.ca en entrevue.
Selon certains, en obligeant simplement Netflix à payer la TVH, cela aiderait à résoudre le dilemme du financement de la production télévisuelle canadienne.
«Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas encore été fait,» a dit Maureen Parker, directrice générale de la Writers Guild of Canada. «Si une entreprise que nous appelons service de télévision par contournent fait affaire au Canada, elle devrait payer des taxes.»
Un porte-parole de Netflix, par contre, a dit à Cartt.ca par courriel que l’entreprise est en conformité avec les lois fiscales partout où elle est en opération.» (Présumément, cela veut dire qu’elle percevrait et verserait une taxe de vente si exigée par le gouvernement fédéral – ce que le gouvernement fédéral a toujours résisté à faire.)
Quant à une contribution à l’écosystème de radiodiffusion canadien, l’entreprise a indiqué qu’elle le faisait déjà par le biais de ses investissements dans le contenu canadien et la production locale.
Par contre, exiger une contribution financière des entreprises de télévision en ligne pour le système canadien de radiodiffusion n’est pas nécessaire, a ajouté le porte-parole. L’entreprise a fait remarquer que des investissements de 8.3 milliards $ en dépenses de production (une somme sans précédent) en 2016/2017 montrent que la croissance des investissements en production canadienne est au rendez-vous sans obligation réglementaire.
«C’est un meilleur indice de succès que les quotas et la réglementation conçus pour une période révolue et pour un autre média.»
«Les contributions que nous faisons sont motivées par les forces du marché et par la grande qualité de l’industrie de la production canadienne. C’est un meilleur indice de succès que les quotas et la réglementation conçus pour une période révolue et pour un autre média. Réglementer la production en ligne comme les radiodiffuseurs traditionnels ne pourrait fonctionner et ce n’est pas nécessaire d’encourager la production de films ou d’émission canadienne,»a ajouté l’entreprise. De plus, il y a l’entente de 500 M$ qu’ils ont faits avec la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly.
Certains ont suggéré que parce que Netflix produit du contenu canadien qui rencontre les exigences du BCPAC, il est normal de s’attendre qu’elle contribue au système comme les EDR. L’entreprise a indiqué que c’était une erreur de croire que Netflix puisse recevoir du financement du Fonds canadien des médias ou des crédits d’impôt pour la production.
«Comme entreprise étrangère, Netflix ne peut produire de contenu canadien seul. Nous devons nous associer avec un radiodiffuseur canadien ou un distributeur indépendant ou un producteur canadien,» a dit le fournisseur des services en ligne. «Nos partenaires canadiens peuvent recevoir de l’argent du FCM ou des crédits d’impôt pour la production pour les projets. Netflix ne reçoit pas de telles sommes.»
D’autres ont également dit que ce serait naïf de croire que l’on pourrait inclure Netflix dans le système actuel.
Pour Brad Danks, PDG du radiodiffuseur indépendant OUTtv il est temps de trouver une nouvelle approche pour intégrer ces nouveaux joueurs dans le système canadien de télévision. Au lieu d’appliquer les vieilles règles dans un environnement de radiodiffusion qui n’existe plus, en partie à cause de l’arrivée de la livraison du contenu en ligne il pourrait être plus simple de créer un nouveau fonds auquel contribueraient les Netflix de ce monde – et qui financerait du contenu canadien.
«Si vous voulez diffuser votre contenu, vous devez suivre certaines règles définies dans notre réglementation, mais nous, comme Canadiens voulons produire et raconter nos propres histoires donc nous allons créer un nouveau fonds auquel vous contribuerez chaque année et nous, nous en ferons ce que nous voulons et notre contribution sera de produire du contenu.» a-t-il expliqué.
«Je pense que parfois, nous mettons des contraintes ou des protections qui sont contraires à l’équilibre naturel» – Kirstine Stewart
Kirstine Stewart, qui possède une longue expérience dans l’industrie de la radiodiffusion à la CBC/SRC et chez Alliance Atlantis, met en garde contre un environnement trop prescriptif qui serait dépassé et pas assez flexible pour les nouvelles réalités.
«Je pense, évidemment, que certains changements peuvent être apportés à la Loi sur la radiodiffusion pour la rendre plus inclusive, mais l’enjeu – le dilemme – est que plus vous êtes prescriptif, plus vous devez vous rabattre sur des formulations comme ‘ toute forme de radiodiffusion existante ou à être inventée’» a-t-elle expliqué.
Madame Stewart ajoute que la politique de la radiodiffusion doit être mieux alignée avec les habitudes et les choix des téléspectateurs.
«Je crois que la politique doit être élaborée de manière ouverte et doit penser davantage à l’utilisateur qu’aux canaux qui rejoignent l’utilisateur parce que je crois que dans de nombreux cas, l’auditeur, l’utilisateur, le téléspectateur, quelle que soit la manière dont on l’appelle finit par déterminer comment il interagira avec le contenu. Et je pense que parfois, nous mettons des contraintes ou des protections qui sont contraires à l’équilibre naturel,» dit-elle.
Danks a noté que Netflix et les autres fournisseurs en ligne ne devraient pas être vus comme des vilains parce qu’ils ont simplement ouvert une porte où les autres vont pénétrer. Au lieu de cela, une partie de la solution au dilemme de la production canadienne réside dans le réexamen de la l’intégration verticale. La politique adoptée par le CRTC est un échec lamentable, argumente-t-il.
L’intégration verticale a rendu les grandes entreprises de médias et de communications plus compétitives entre elles, mais n’a rien fait pour rendre l’industrie canadienne compétitive face aux services américains qui entrent au pays.
«L’attitude qui prévaut dans le secteur est d’affamer les indépendants et de tout donner aux entreprises intégrées verticalement avec l’espoir qu’ils nous emmèneront à la terre promise.» – Brad Danks
«L’attitude qui prévaut dans le secteur est d’affamer les indépendants et de tout donner aux entreprises intégrées verticalement avec l’espoir qu’ils nous emmèneront à la terre promise,» dit-il. «Cela ne veut pas dire que l’on ne doive pas envisager une plus grande intégration corporative ou autres choses, mais nous ne pouvons envisager l’intégration verticale qui veut dire, et je le pense vraiment, être plus compétitif à l’intérieur du système canadien de radiodiffusion comme stratégie alors que le monde devient numérique et global. Et c’est là le nœud du problème.»
De la perspective des consommateurs ce ne devrait pas être de taxer Netflix ou Amazon Prime, mais de les inciter à diffuser plus de contenu canadien. John Lawford, directeur général du Centre pour la défense de l’intérêt public, suggère qu’un système de quota pourrait être une option intéressante.
«Je ne crois pas que l’on tente de donner à Netflix un passe-droit. Ce que l’on veut dire, c’est que peut-être, ils pourraient être convaincus, si on veut, de façon réglementaire de faire de la production canadienne eux-mêmes et que peut-être qu’éventuellement avec le temps nous trouverons comment faire pour les étapes suivantes» a-t-il dit.
La cinquième partie sera un entretien avec un PDG canadien avec des opinions très arrêtées sur les nouvelles Lois et ce qu’elles devraient être.
La sixième partie explorera la neutralité de l’Internet et son rôle fondamental dans la législation sur les communications.
Traduction française par Denis Carmel.
Oeuvre originale de Paul Lachine, Chatham, Ont.